Maladie et congés payés : la Cour de cassation récidive
Congés payés et maladie, heures supplémentaires, éclairage sur les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation.
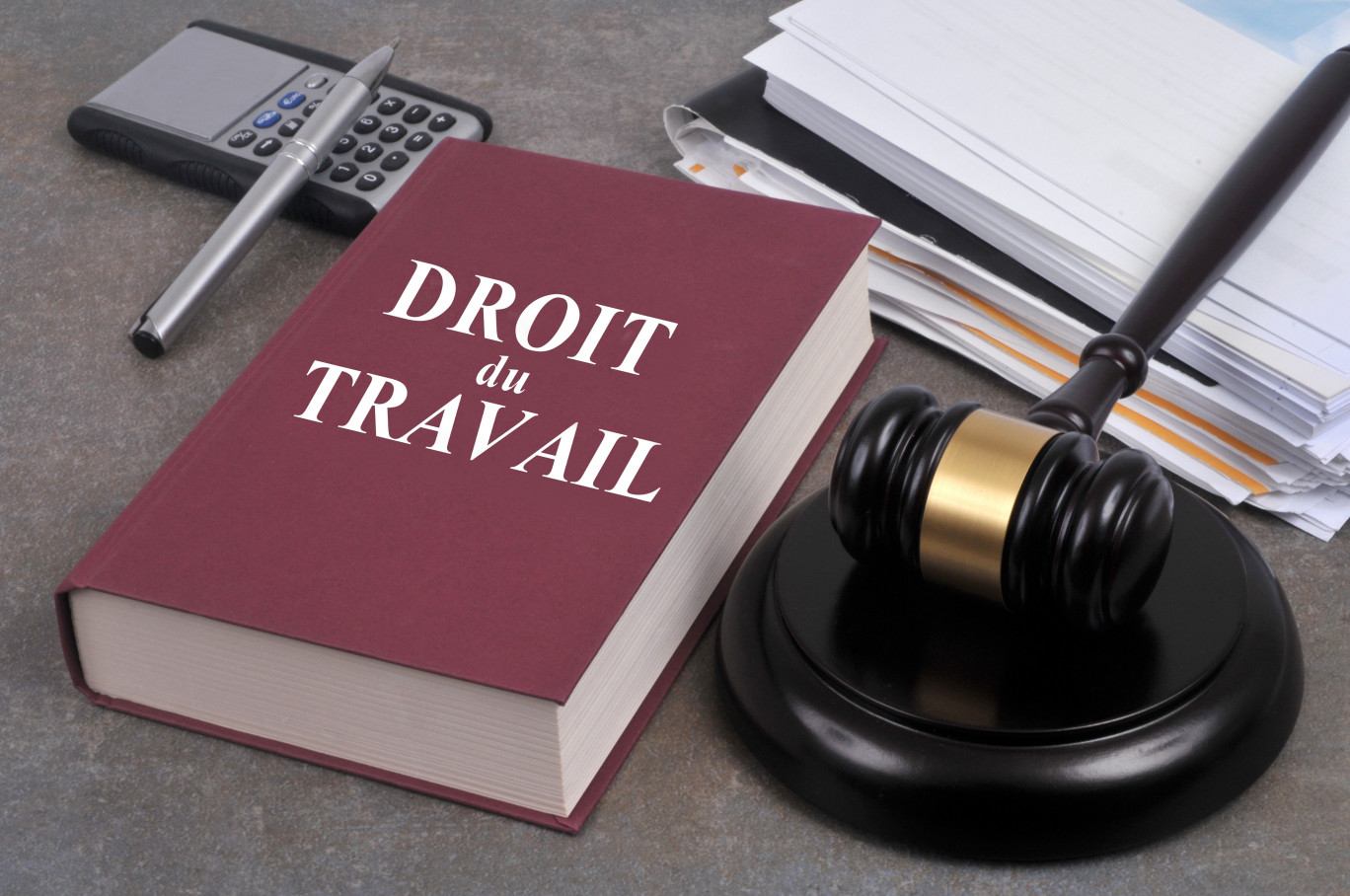
On sait désormais que depuis l’adoption de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 les salariés acquièrent des congés payés pendant un arrêt maladie. Cette nouvelle réglementation fait suite à une directive 2003/88/CE, prévoyant que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines », sans opérer aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période. On se souvient que loi du 22 avril 2024 avait été précédée de revirements de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 septembre 2023, pourvois n°22-17340 et 22-17638).
Deux ans après ce tsunami, la Cour de cassation récidive sur le même thème par deux arrêts rendus le 10 septembre dernier (Cass. soc., 10 septembre 2025, pourvois n° 23-22732 et n°23-14455) . Plus précisément, deux questions lui étaient posées :
- le salarié qui tombe malade durant ses congés payés peut il les reporter ?
- Les jours de congés payés doivent-ils être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, même s’ils ne relèvent pas du temps de travail effectif ?
Le salarié qui tombe malade pendant ses congés peut les reporter
Auparavant, le principe était qu’un salarié en arrêt maladie pendant ses congés ne pouvait pas demander à les récupérer, sauf disposition conventionnelle contraire (Cass. soc. 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44907). Ce principe résidait sur l’idée que le congé était la cause initiale de la suspension du contrat de travail. Résultat : le salarié cumulait le versement de ces congés payés par l'employeur et les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'assurance maladie (en revanche, il ne pouvait prétendre au versement des prestations complémentaires).
Toutefois, ce raisonnement n’allait pas dans le sens de la législation et de la jurisprudence européenne. En effet, rappelons que la directive sur le temps de travail (2003/88/CE) impose aux États membres de garantir un repos effectif au titre du congé annuel, et prévoit un congé minimal de quatre semaines. Et, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés, il doit pouvoir reporter les jours non réellement pris (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11).
Ce faisant, l'Europe distingue clairement le droit à loisir (congés), et le droit à repos (maladie), l'un ne s'imputant pas sur l'autre !
La Cour de cassation opère un revirement : le salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés, dès lors qu’il a notifié à son employeur cet arrêt, pourra désormais reporter ses congés.
Les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, même s’ils ne relèvent pas du temps de travail effectif
Jusqu'à présent les heures supplémentaires étaient comptabilisées à compter du travail effectif ( Code du travail, art. L 3121-1). Imaginons un salarié qui travaille selon une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 h (générant donc théoriquement des heures supplémentaires), mais qui, sur certaines semaines, a pris des jours de congé. Or, et dès lors que des congés ont été pris dans la semaine, les heures supplémentaires ne sont calculées que pour les temps supérieurs au travail effectif, c'est-à-dire de travail dans l'entreprise.
Désormais la Cour de cassation assimile ces congés à du travail effectif … Le principe qu’elle définit est simple : « lorsque le salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, a, pendant la semaine considérée, été partiellement en situation de congé payé, il peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine ».
Ces jurisprudences ont évidemment été saluées par les syndicats, mais dénoncées avec vigueur par le patronat.
Pour l’heure, le ministre démissionnaire de l'Industrie, Marc Ferracci, s’est contenté de déclarer : « on a besoin d'abord de discuter avec la Commission européenne pour voir ce que, au niveau du droit français, on peut envisager comme aménagement, comme un plafonnement, par exemple ».










