Commerce/ C’est à lire
Le marché, outil de politique publique inexploité
Alimentation saine, lien social, économie de proximité...Bien que le marché soit en phase avec de nombreux objectifs des politiques publiques, ces dernières l'oublient souvent, constate Olivier Razemon dans un ouvrage qui décrypte toutes les facettes de ce phénomène qui persiste depuis le Moyen-Age.
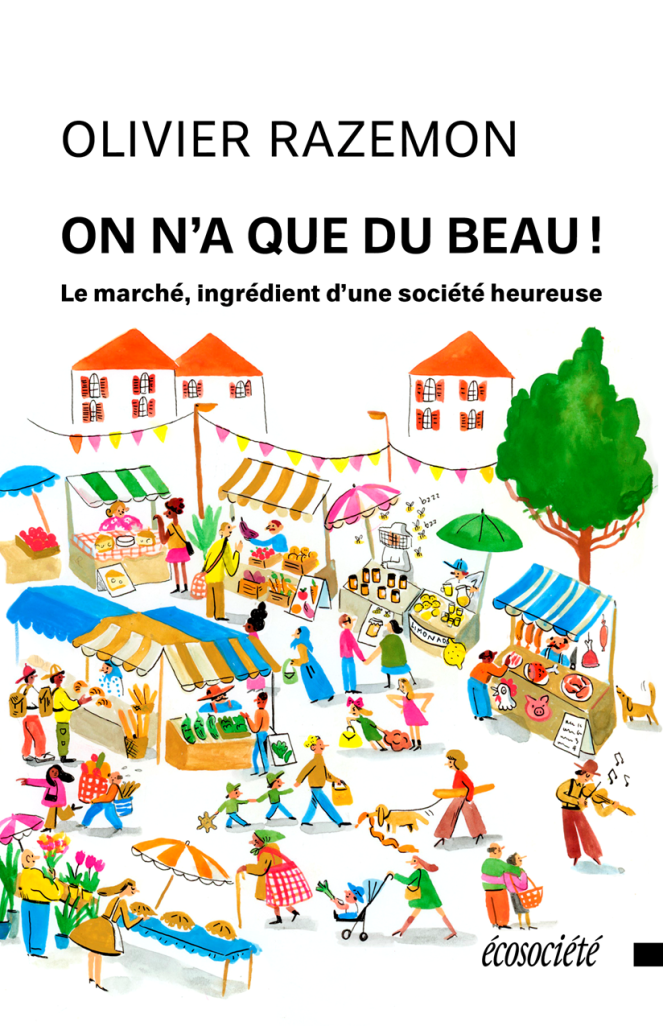
Les candidats aux élections ne manquent jamais de s'y rendre, les offices du tourisme utilisent volontiers son image. Pourtant, le marché demeure un objet mystérieux et son potentiel comme outil de politique publique reste sous-employé, constate Olivier Razemon, journaliste et auteur, dans « On n'a que du beau ! Le marché ingrédient d'une société heureuse » ( Ed. Ecosociété). L'ouvrage décrypte les facettes socio-économiques du « marché forain » -sa dénomination officielle- et l'enjeu de politique publique qu'il représente.
Première précision, le « marché forain » a trois caractéristiques. Il se tient de manière temporaire, sur le domaine public et le plus souvent en extérieur. C’est un héritage du lointain passé. Au Moyen-Age, déjà, le seigneur qui fondait une bastide octroyait un « droit de marché » établi sur la place centrale. On sait qu'en 970, à Tournus (Saône-et-Loire,) le marché se tenait le samedi... Plus d'un millénaire plus tard, le marché est toujours là.
« Chaque semaine, il s'en tient des milliers dans l'Hexagone. (…) Il a survécu aux chaos de l'Histoire et à toutes les formes de concurrence », super et hypermarchés, galeries marchandes, e-commerce...
Autre constat, en se tournant vers le futur : les caractéristiques du marché s'accordent avec une transition vers une société de la sobriété qui prend en compte les enjeux écologiques et sociétaux. « Il incarne des valeurs essentielles à la vie humaine que les pouvoirs publics ont repris à leur compte : l'alimentation saine, la conscience de la nature, l'urbanité, la diversité », résume Olivier Razemon. De fait, certaines villes font la promotion de leurs marchés. Comme Lyon, où s'affiche une campagne qui leur est consacrée sur les panneaux publicitaires : « Et vous, quel est votre marché préféré ». A Cannes, autre campagne. Les slogans « Besoin de se fendre la poire ? » ou « Pas envie de vous prendre le choux ? » sont suivis de la liste des marchés dans la ville...
« Résister à la tentation facile de la halle gourmande »
Mais ces exemples constituent des exceptions. Depuis une quinzaine d'années, les politiques publiques prônent « l'alimentation de qualité, la revitalisation des petites villes ou les rencontres entre riverains. Toutes, pour une raison ou pour une autre, pourraient s'appuyer sur les marchés. La plupart du temps, elles les ignorent », analyse Olivier Razemon. Exemples : le programme « Villages d'avenir », lancé en décembre 2023 pour revitaliser les communes de moins de 3 500 habitants ne prend pas en compte les marchés. Même constat pour les programmes « Action cœur de ville » (pour les villes moyenne) ou « Petites villes de demain ». Avec les politiques, les spécialistes de la ville aussi passent à côté du phénomène. « L'histoire, le fonctionnement et les ressorts du marché restent méconnus. Ses administrateurs, une multitude d'acteurs publics et privés, peinent à dynamiser l'événement. Les administrations municipales elles mêmes, qui en sont les gestionnaires, ne savent pas comment réagir aux récriminations des commerçants ambulants qui ne votent pas dans la communes », note Olivier Razemon.
En matière de gestion, les communes ont deux possibilités. La première : octroyer une délégation de service public à une entreprise qui s'occupe de tout ( fourniture et maintenance des équipements, recrutement des commerçants, gestion des emplacements....) . La seconde, une gestion directe. « un beau marché se porte mieux lorsqu'il est administré directement par la municipalité », estime l’auteur. Il met aussi en garde : « les élus doivent résister à la tentation facile de la halle gourmande, un lieu de consommation visant une clientèle sans souci d'argent, pensé selon le même modèle d'un bout à l'autre de la planète, et dont le fonctionnement obéit aux seuls impératifs de la rentabilité financière. Les halles ne sont pas un parc d'attractions ; elles doivent rester ouvertes à tous, et à tous les commerçants . La place marchande traditionnelle présente un atout inestimable : elle repose sur une myriade de sociétés indépendantes et forme une économie locale, humaine, qui enrichit les petits plutôt que les gros. Dans une société divisée, mal aimante, le marché plaît à tous et apporte de la sérénité ».











 Se connecter
Se connecter