RH
Santé au travail : des signaux faibles en hausse
Le dernier baromètre Ekilibre-OpinionWay, publié en juin* révèle les causes profondes du mal-être au travail. Au-delà d’une satisfaction globale encore élevée (68 %), cette donnée moyenne masque des signaux d’alerte puissants avec des indicateurs de souffrance au travail en forte hausse. Et ce sont bien les conditions d’exercice du travail qui en seraient la cause première.
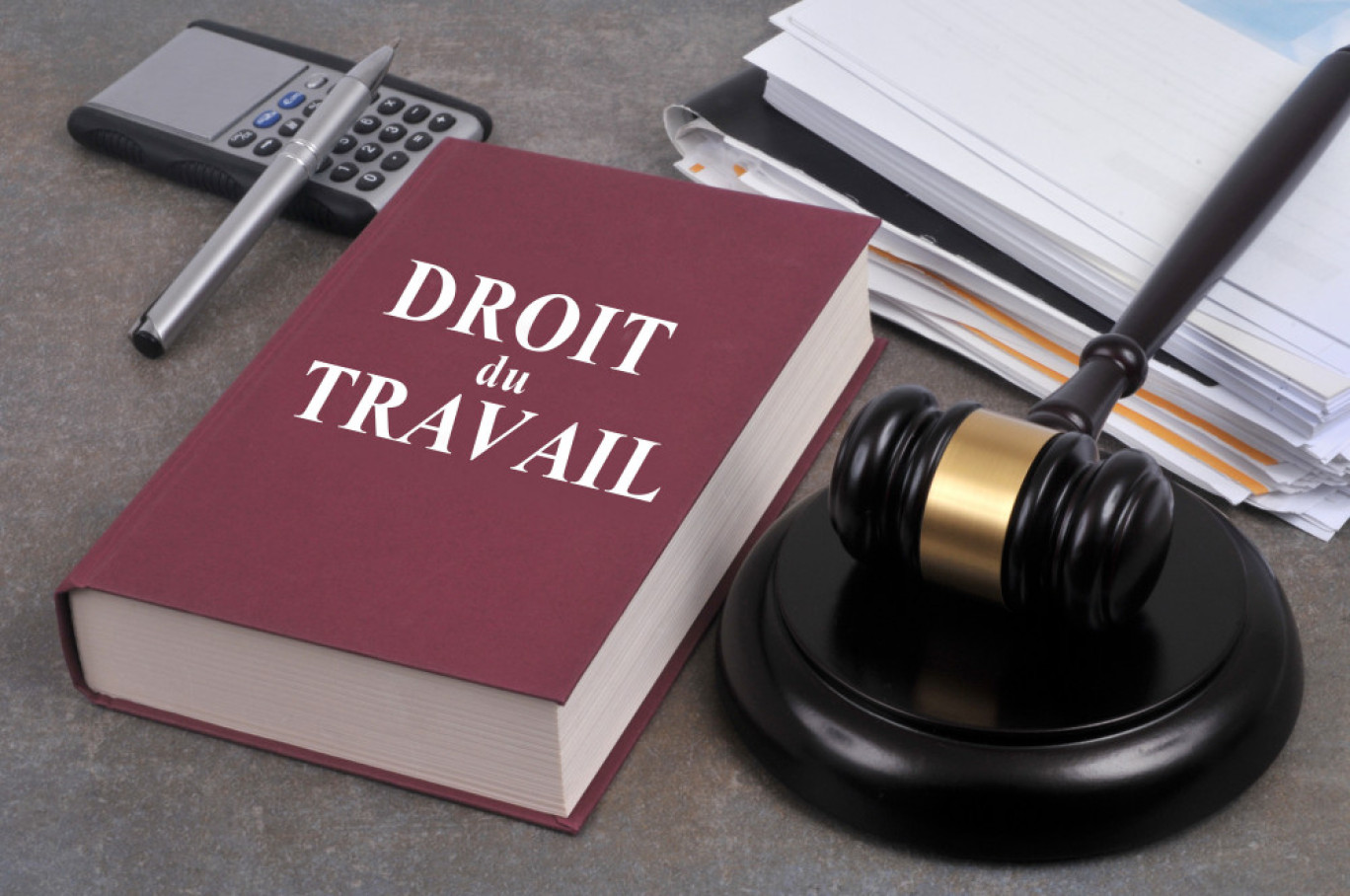
Fatigue chronique, stress intense, sentiment d’inutilité, manque de reconnaissance, mal-être, violences internes ou externes : les signaux faibles s’accumulent. Plus d’un salarié sur deux est en situation de vulnérabilité au travail. 51,5 % des salariés interrogés présentent au moins un indicateur à un niveau élevé ou très élevé parmi la fatigue, le stress, la pénibilité physique ou le mal-être.
La moyenne de satisfaction globale (6,9/10) masque donc une fracture bien plus profonde. Le mal-être, en particulier, concerne 76 % des répondants, avec un impact direct sur leur santé mentale ou physique — parfois les deux, dans trois quarts des cas. Plus préoccupant encore : 20 % des répondants affirment avoir été arrêtés au moins une fois au cours des six derniers mois pour un motif lié à leur activité professionnelle. Ce n’est plus seulement une question de bien-être individuel, mais un enjeu systémique. D’autant que les salariés concernés n’ont pas toujours les ressources pour faire face : un tiers d’entre eux ne disposent d’aucune personne de confiance, ni en interne ni en externe, à qui en parler.
Une organisation du travail sous pression
Les causes de cette vulnérabilité sont multiples. D’abord, l’intensité du travail : 64 % des salariés affirment que leur activité exige une vigilance permanente ; 39 % se disent soumis à des rythmes élevés, 38 % à des interruptions fréquentes, 34 % à des changements de tâches ou de fonction non anticipés. À cela s’ajoute l’inadéquation entre les objectifs fixés et les moyens humains ou matériels disponibles. Les exigences émotionnelles sont également élevées : près d’un salarié sur deux déclare devoir « faire bonne figure » en toutes circonstances, même quand il ne va pas bien. Près d’un quart indiquent manquer de reconnaissance dans leur travail, indépendamment de la rémunération, et 29 % estiment ne pas recevoir un soutien suffisant de leur hiérarchie directe.
Dans les métiers de contact, le manque de moyens pour faire face au mal-être d’autrui (clients, patients, usagers…) ajoute à la charge mentale. Quant à l’autonomie, elle est souvent restreinte : environ 18 % manquent de marge de manœuvre sur le rythme ou les modalités d’exécution de leur travail, et 17 % se sentent empêchés d’utiliser ou développer leurs compétences. C’est une source majeure de démotivation et de perte de sens, alimentée par un climat d’incertitude (changements mal anticipés, sentiment de faire un travail inutile, doutes sur la pérennité de l’activité…).
Des violences encore trop fréquentes
Le baromètre révèle également une prévalence inquiétante des violences au travail (verbales, psychologiques ou physiques). Un quart des salariés sondés en ont déjà été victimes, dont 13,5 % en interne (de la part de collègues ou de la hiérarchie). Parmi eux, 58 % estiment avoir été confrontés à du harcèlement moral, 19 % à du harcèlement sexuel ou sexiste. Ces violences sont subies « parfois » ou « souvent » traduisant une exposition régulière, et non marginale. « Les violences s’installent dans les organisations de façon silencieuse pour partie », signale Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et des organisations, Dg du cabinet Ekilibre Conseil, consultant expert en prévention des risques psychosociaux. Ces situations restent en effet largement sous-déclarées : seuls 41 % des salariés savent s’ils dispose des violences encore trop fréquentent d’un dispositif de signalement pour les faits de harcèlement, et 38 %, en cas de mal-être ou souffrance. Le sentiment d’insécurité relationnelle est donc renforcé par l’absence de recours visibles et accessibles. Autre sujet de préoccupation : 33 % des salariés ne savent vers qui se tourner en cas de souffrance. Et parmi les personnes les plus vulnérables, 26 % n’identifient aucune ressource interne de confiance dans leur entreprise. « Il faut réhabiliter la fonction RH dans un rôle de care et de soutien », affirme Jean-Christophe Villette.
Une mobilisation encore trop inégale
Face à ces constats, les actions de prévention mises en œuvre par les entreprises apparaissent encore insuffisantes. Moins de la moitié des salariés jugent que leur employeur agit concrètement pour préserver leur santé mentale ou physique. Seuls 23 % ont bénéficié d’une formation sur les risques psychosociaux (RPS) au cours des trois dernières années. Et pourtant, les attentes existent. Quand on interroge les salariés sur les personnes de confiance qu’ils solliciteraient en cas de souffrance, ils citent en premier lieu leurs collègues (72 %), puis leur manager direct (33 %), un délégué du personnel (21%) ou un médecin du travail ( 21%), bien avant les ressources humaines (11 %) ou les référents harcèlement (9 %). « On dit que les RH, les CSE et les managers sont les premiers remparts, mais ils ne sont pas efficients en réalité. Les formations qui s’adressent aux managers devraient s’adresser aux collaborateurs qui sont les premiers relais de confiance dans les entreprises », commente Jean-Christophe Villette. Il y a là une opportunité forte pour les entreprises : structurer ces relations de proximité, renforcer les compétences managériales en matière d’écoute et formaliser les canaux de signalement.
Agir sur les causes racines
Pour l’expert, il faut « rompre avec la prévention cosmétique » et réinterroger les conditions de travail et les modes de management. « Ce n’est pas avec deux séances de yoga que l’on va pouvoir accompagner à la hauteur des enjeux. Nous ne sommes plus dans un signal faible, mais dans un cas social majeur », prévient-il. Au-delà des obligations légales du Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), les entreprises doivent mettre en œuvre un diagnostic organisationnel. Et mettre en place des leviers d’action que l’enquête met en avant, telles que la reconnaissance au travail, le soutien managérial, la cohérence des objectifs pour les rendre compatibles avec les moyens humains et matériels disponibles, la clarification des priorités, la qualité des rapports sociaux, le renforcement de l’autonomie et des marges de manœuvre ou encore l’anticipation des changements. Tous ces éléments constituent le socle d’un environnement de travail sain et durable.
Pour les directions RH et les dirigeants, le défi est double : prévenir les risques, mais aussi repenser en profondeur l’organisation du travail. Car il ne s’agit pas seulement de mettre en place des outils ou des lignes d’écoute, mais bien de traiter les causes racines du mal-être au travail. Et ainsi renforcer la résilience, la performance et l’engagement de leurs équipes dans la durée.
* Enquête réalisée en avril et mai 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1 025 salariés du public et du privé











 Se connecter
Se connecter