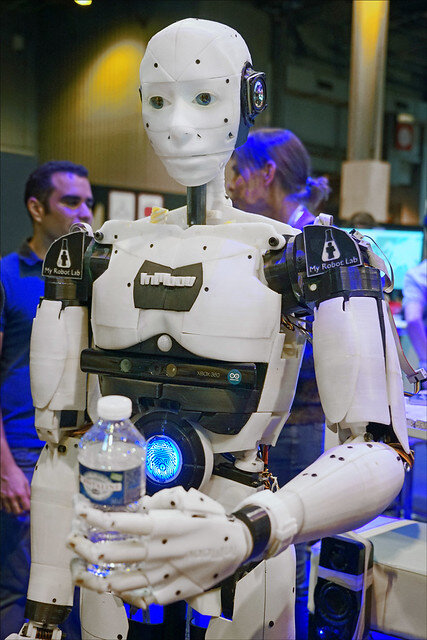Face à l’ambition de relocaliser des pans entiers de l’industrie - automobile, agro-alimentaire, pharmacie, ameublement… - et face à la difficulté de recruter certains personnels, les robots restent une option valide. Grâce à l’intelligence artificielle (IA) - en particulier l’analyse d’images -, la robotique montre des progrès considérables dans l’approvisionnement des chaînes de montage, dans le contrôle des process, dans l’optimisation des ressources, dans le suivi de qualité, etc.
Malgré un ralentissement possible des investissements, le marché des robots, en France comme en Europe devrait croître de 8 à 10% en 2025. Les robots dits « collaboratifs » (en appui de la production et des tâches effectuées par des humains) représentent une tendance forte, avec une progression moyenne dépassant les 25% sur cinq ans, tandis que les robots mobiles autonomes (AMR) devraient connaître une croissance moindre, avoisinant les 20% (source : Markets & Data). Tous les secteurs d’activité s’y intéressent désormais et pas seulement l’automobile : transport et logistique (gestion d’entrepôts ou « intralogistique »), distribution, santé…
Une organisation en flottes
Les robots savent parfaitement déplacer de lourdes charges (jusqu’à 1,5 t. comme chez Omron, ou Sherpa Mobile Robotics, à Haguenau) de manière autonome et sans pause, hormis la recharge d’énergie et de rares arrêts de maintenance.
Ces robots mobiles peuvent être organisés en flottille, se déplacer dans des zones bien définies et sont capables de se relayer en cas de panne. Ils savent saisir de gros ou petits objets dans des étagères ou sur un plateau et les déposer sur une ligne de fabrication, ou transporter des palettes, des conteneurs. Ils héritent des capacités et du savoir-faire d’une autre catégorie d’équipements autonomes : les « véhicules guidés automatisés » (AGV), lesquels se rapprochent également du concept de « drones terrestres ».
Ainsi, comme observé récemment dans un centre de développement pilote de la firme japonaise Omron à Stuttgart, on peut voir évoluer librement des petits robots transportant des pièces ou des conteneurs qu’ils acheminent sans arrêt entre plusieurs postes de production - assemblage de cartes électroniques, encapsulage de flacons, contrôle de pièces, etc.
Ces robots mobiles autonomes ne dépendent pas de repères physiques - bandes magnétiques ou câblage au sol, bornes ou boucles d’induction, etc. Ils perçoivent tout leur environnement grâce à une ou deux caméras associées à des capteurs intelligents - dont des radars ‘lidars’ détectant la lumière, la distance ; ou des rayons infrarouges ou laser, ou encore des ultrasons. Ils savent combiner plusieurs sources, comme lire des QRcodes ; ils peuvent en permanence reconfigurer leurs déplacements en s’évitant les uns les autres ; ils sont également capables de se relayer si l’un d’eux est parti se recharger en énergie ou a subi une panne. Etant effectivement organisés par flottes - jusqu’à plusieurs dizaines de robots-, ils produisent et mettent à jour leur carte 3D correspondant à leur zone d’interaction.
Sur certains modèles, il existe également, pour la sécurité, des encodeurs sur les roues relevant l'itinéraire et les rotations ainsi que des capteurs inertiels ; on mesure ainsi les moindres mouvements et accélérations du robot.
La sécurité en question
La sécurité reste un critère crucial : toute collision doit être évitée. Si une personne ou un objet se met en travers de sa route, le robot s’immobilise sur le champ. Il attend ou émet un bip et allume une lampe rouge d’alerte, jusqu’à l’intervention d’un humain. Il peut également se mettre à l’arrêt s’il perçoit la moindre résistance. Ces brillantes petites machines sont donc aptes, comme les robots collaboratifs, à travailler à proximité immédiate de personnes.
Au traitement en temps réel de toutes les données collectées, l’IA ajoute des strates de prise de décision et d’autonomie, en fonction des modèles d'apprentissage automatique programmés. L’enjeu est de s'adapter encore mieux et avec plus large flexibilité à un environnement potentiellement changeant (incidents, pannes, perturbations électriques, météo…). Cet environnement est de plus en plus constitué d’objets connectés (cf. IoT). D’où la nécessité de communiquer avec les autres systèmes d’information : informatique de gestion (IT), informatique industrielle (MES, manufacturing execution system) et gestionnaire d’entrepôt (WES, warehouse execution system). L’objectif clé est d’optimiser le flux de travail, de prioriser les tâches, depuis l’approvisionnement, la production, le contrôle qualité, toute la logistique jusqu’à la livraison.
Ceci explique des rapprochements entre firmes comme entre Omron et Cognizant, un spécialiste de l’analyse des données.
L’option RaaS
La flexibilité concerne également l’accès à ces ressources souvent coûteuses. Les investissements peuvent être très conséquents, les prix variant de 1 000 euros pour des petits robots, à 50 000 voire 100 000 euros pour les plus sophistiqués, capables de porter de lourdes charges. Ceci explique que les fournisseurs ont mis en place des solutions de location-achat (ou leasing).
Une tendance nouvelle consiste à louer le service : on parle alors de RaaS (robotic as a service ; cf; Locus Robotics, Robotique Concept…). Le fournisseur assure la livraison, la maintenance (jusqu’à 7 jours sur 7), les mises à jour logicielles, voire l’exploitation des données, à un tarif mensuel forfaitaire ou à l’usage. C’est une option à étudier pour tester, valider une implémentation partielle, en vue d’un futur fonctionnement à flux tendu. Cette phase pilote sans investissement peut permettre de vérifier les embûches techniques, comme les trous dans la couverture radio ou les interférences entre systèmes - la hantise des responsables de sites industriels.