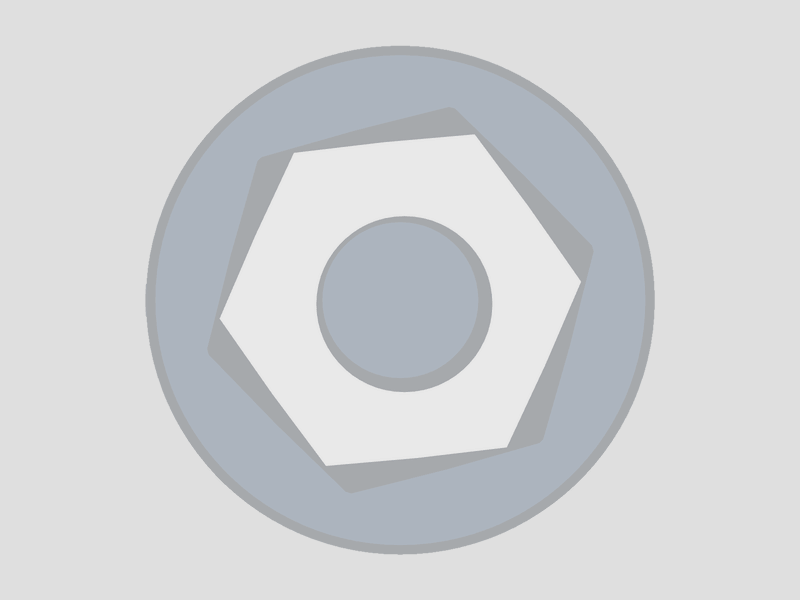Le territoire s'organise pour l'arrivée du TGV à Amiens
Fin juin, les Universités d’été de l’économie amiénoise étaient consacrées au barreau ferroviaire Roissy-Picardie qui doit entrer en service en 2027. Élus, entrepreneurs, chercheurs et acteurs locaux ont réfléchi à l’impact de l’arrivée du TGV à Amiens.

«Je me suis toujours battu pour le barreau Roissy-Picardie, qui deviendra une réalité en 2027», rappelle Hubert de Jenlis, maire d’Amiens, lors du lancement des Universités d’été de l’économie amiénoise. Ce 24 juin à Amiens, ce rendez-vous annuel entendait analyser les enjeux liés à l’arrivée du TGV dans la ville d’ici deux ans. Cette liaison incarne, selon l’édile, un véritable tournant pour Amiens, en la reliant au hub de Roissy en moins d’une heure, mais aussi au «reste du monde».
De son côté, Alain Gest, président d’Amiens Métropole, salue la mobilisation générale autour de cette infrastructure attendue depuis 40 ans. «Ce projet n’aurait pas abouti sans le soutien des collectivités locales de la Somme et de l’Oise, mais également de la Région Hauts-de-France», souligne-t-il. Évalué à 541 millions d’euros, le coût du barreau Paris/Roissy sera supporté à 65,32% par l’État, 26,24% par la Région, 6,52% par les collectivités, et 1,92% par l’Union européenne.
Six petits kilomètres pour un changement majeur
Si la création d’une section ferroviaire de 6,5 kilomètres, entre Amiens à Roissy en passant par Creil, pourrait s’apparenter à un «petit chantier, il n’en est rien», pour Emmanuel Grossin de SNCF Réseau. «C’est au contraire un grand projet, tant par sa complexité, les moyens financiers alloués, que par les ambitions qu’il porte. Il sera ainsi possible de relier Roissy depuis Amiens en une heure, et Creil en 20 minutes», indique-t-il. Par ailleurs, Lyon et Strasbourg seront accessibles en trois heures, et Marseille en cinq heures à partir de l’ex-capitale picarde.
«Nous attendons quatre millions de voyageurs dès la mise en service de la ligne en 2027, et sept millions après vingt ans d’exploitation», précise Emmanuel Grossin. Cette ligne devrait aussi éviter environ 100 000 trajets en voiture par an. «Je tiens à couper court aux rumeurs qui circulent : il y aura bien des TGV sur cette ligne», assure pour sa part Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. «Il y a deux logiques sur ce barreau : une circulation à 160 km/h assurée par de nouveaux trains commandés par la Région, mais aussi de la grande vitesse», ajoute-t-il.
Penser le projet de territoire
Tous les intervenants ont cependant tenu à rappeler qu’une ligne à grande vitesse seule n’était rien. «Le TGV ne déverse ni emplois ni touristes», tance Marie Delaplace, enseignante-chercheuse à l’université Gustave Eiffel. «Pour réussir on a besoin de foncier, de formations, de stratégies de filières et de la force du collectif», abonde François Dutriez, directeur général adjoint de Nord France Invest.
Pour sa part, Sébastien Alavoine, de l’Institut Paris Région, insiste sur le besoin de mettre en œuvre un véritable projet de territoire. Un avis partagé par Nicolas Blangy, président du Medef de la Somme. «Avant d’attirer des entreprises, il me semble qu’il est important de conserver celles qui sont sur le territoire. La fréquence est un point important mais il ne faut pas occulter non plus la liaison entre Paris et Amiens qui reste problématique. Nous avons besoin d'être rattachés de façon qualitative à ce pôle économique majeur», met-il en garde.
L’exemple de Reims
Après vingt ans d’attente, le TGV s’est arrêté à Reims en 2007, plaçant la collectivité à 45 minutes de Paris. «Cela nous a permis d’entrer dans la cour des grands», analyse Arnaud Robinet, maire de Reims. Outre l’installation de nouveaux habitants, la LGV a aussi entraîné l’implantation des campus de Sciences Po, de l’Institut Catholique de Paris, mais aussi l’agrandissement de l’école de commerce Neoma. Plus inattendu, le Grand Reims s’apprête à accueillir le pôle européen du cinéma porté par Mediawan. «Cela veut dire que c’est toute une filière autour des métiers du cinéma qui va se structurer, ce que nous n’avions pas vu venir», confie l’élu. Lequel rappelle cependant que ces effets positifs ne sont pas immédiats. «Les acteurs locaux doivent avoir une vision à dix, quinze et même vingt ans pour accompagner cette arrivée», pointe celui qui tient d’ailleurs à conserver une identité de ville moyenne, entourée par les champs et les vignes. «Je pense qu’il est important de continuer à nous développer tout en conservant une vraie qualité de vie et d’aménagement urbain», temporise-t-il.











 Se connecter
Se connecter